Apaiser les morts pour guérir les vivants : quand les mémoires du tragique nourrissent les douleurs du présent.
Apaiser les morts pour guérir les vivants – le seuil entre les deux rives.
© www.voiesymbolique.net - Paris - Cimetière du Père Lachaise - caveau Raspail - novembre 2021
Introduction – Le souffle coupé du monde
Le monde traverse une période de fractures multiples : guerres, exils, violences, dérives autoritaires. Les conflits d’hier semblent se répéter sous d’autres noms, comme si le XXᵉ siècle n’était jamais tout à fait terminé.
Les morts du siècle passé, ceux des camps, des goulags, des déportations, des famines ou des épurations, n’ont pas tous trouvé la paix.
Et si les blessures qui agitent aujourd’hui notre humanité n’étaient pas seulement politiques ou économiques, mais mémorielles ?
Et si le tumulte du présent était aussi le souffle inachevé des morts qui cherchent encore, à travers nous, leur apaisement ?
A l’heure de la Toussaint (1er novembre) et de la Fête des morts (2 novembre) : la question ne vaut-elle pas d’être posée ?
Selon mon expérience concrète de médium et de thérapeute en constellations familiales certifié COFASY (2016) : ce qui n’a pas été pacifié dans le monde invisible continue d’agir dans le visible.
C’est une responsabilité collective et spirituelle : aider à la pacification du monde des morts pour alléger celui des vivants.
Et, sous-jacente à cette responsabilité, se trouve une autre tâche : restaurer la continuité du souffle entre les deux rives, rendre à la Vie sa circulation naturelle.
Comme toujours, ce qui suit est un témoignage et ne consiste en rien une tentative de convaincre. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste là.
1. Le champ invisible du monde
Des millions d’êtres humains meurent dans la peur, la colère ou l’injustice.
Or la mort, loin d’effacer ces émotions, les transforme en mémoires vibratoires.
Elles demeurent actives dans le champ collectif, sous forme d’égrégores — ces agrégats de conscience chargés de peine ou de violence.
Elles cherchent à se résoudre, mais faute de conscience, elles se rejouent.
Les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok ( L’écorce et le noyau, 1987 ) ont nommé ces traces des fantômes:
“Ce qui n’a pas été symbolisé par une génération revient hanter les suivantes.
Ce que l’individu refoule, la descendance le répète ; ce que l’humanité refoule, l’histoire le reproduit.”
Nous vivons donc dans un monde peuplé de mémoires inachevées.
Elles s’expriment à travers des colères collectives, des nationalismes, des peurs identitaires.
Elles s’infiltrent dans nos choix politiques, nos guerres, nos relations, parfois même dans nos rêves.
2. L’histoire qui se répète : de la mémoire au mythe
Plusieurs penseurs ont décrit ce mécanisme où le trauma devient matrice de répétition.
Paul Ricoeur – La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000)
Ricoeur distingue la mémoire fidèle – celle qui reconnaît et intègre – de la mémoire instrumentalisée, qui sert à justifier la vengeance ou la domination.
“La mémoire empêchée se change en idéologie.”
Une mémoire blessée, utilisée comme arme identitaire, finit par reproduire la blessure qu’elle dénonce.
Hannah Arendt – Les Origines du totalitarisme (1951)
Arendt a montré comment les humiliations collectives engendrent la tentation de la puissance.
“Ceux qui furent victimes hier deviennent souvent bourreaux demain, si la douleur n’est pas transmuée en pensée.”
Quand la souffrance n’est pas pensée, elle devient programme.
Françoise Sironi – Bourreaux et victimes (1999)
Sironi observe chez les descendants de victimes de guerre ou de génocide un processus d’identification au bourreau :
“Ce que je ne peux plus supporter d’être, je le deviens dans l’autre polarité.”
C’est l’un des paradoxes les plus tragiques : pour ne plus être impuissant, on reproduit la puissance destructrice.
Marianne Hirsch – The Generation of Postmemory (2012)
Hirsch parle de post-mémoire : les enfants des survivants héritent des émotions de leurs parents comme s’ils les avaient vécues.
Cette mémoire héritée, si elle n’est pas travaillée, devient une identité défensive.
Là encore, la souffrance devient repère : ce qui devait servir la mémoire finit par figer la vie.
Ainsi, les drames collectifs – les massacres de masse, les crimes contre l’Humanité, le colonialisme, les famines, les déportations, etc. – continuent d’informer, de nourrir inconsciemment nos comportements actuels.
L’inconscient collectif n’a pas de calendrier ; il cherche seulement la résolution.
S’il fallait s’en convaincre, il suffit de considérer à quel point “La grande guerre patriotique” et “Le siècle d’humiliation” sont aujourd’hui mobilisés, respectivement en Russie et en Chine, pour légitimer des politiques de puissance et de contrôle — au dehors comme au dedans..
3. Le mécanisme du retour : la mémoire comme champ d’attraction
Dans la perspective systémique et transgénérationnelle, un événement traumatique non reconnu crée un déséquilibre dans le champ.
Le système, qu’il soit familial ou collectif, cherche l’homéostasie (stabilisation) : il pousse certains de ses membres à rejouer l’événement pour tenter, inconsciemment, de le résoudre.
C’est pourquoi les descendants d’une histoire de domination peuvent devenir dominateurs à leur tour, croyant s’affranchir de la souffrance en la renversant.
Mais la mémoire, non intégrée, n’apprend pas : elle reproduit.
Ce que nous appelons “le retour du tragique” n’est souvent qu’un appel à la conscience non entendu.
4. L’écologie de la mémoire
Nous parlons volontiers d’écologie de la planète, mais très peu d’écologie de la mémoire.
Pourtant, la Terre est saturée de mémoires humaines, de champs d’émotions non apaisés.
De la même manière qu’un sol trop pollué ne peut plus nourrir la vie, une conscience collective saturée de non-dit étouffe la joie.
Apaiser les morts devient alors un acte d’hygiène spirituelle.
Non pas un culte, mais un soin.
Il s’agit de rendre au monde invisible la paix dont il a été privé :
nommer les morts oubliés,
reconnaître les injustices,
restaurer la dignité des exclus,
reconnaître que “l’ennemi” est, dans le fond, le semblable de “la victime”,
rendre à chacun sa part de responsabilité,
cesser d’alimenter les mémoires de haine par des discours de vengeance en nourrissant une compassion illimitée vers les souffrances endurées (des deux côtés). C’est d’ailleurs le point clef qui permet que tout bascule.
Chaque acte de reconnaissance apaise un champ.
Chaque parole juste restaure une circulation du souffle.
5. S’incliner sans s’immiscer : honorer pour pacifier
Il ne s’agit pas de pardonner, car le pardon suppose encore un geste de pouvoir — un “faire” qui s’immisce dans l’histoire.
Or l’histoire appartient à ceux qui l’ont vécue.
Vouloir pardonner à la place des protagonistes reviendrait à prendre un rôle dans le passé et, ce faisant, à réactiver ce qui cherche simplement à se reposer.
Ce que nous pouvons, en revanche, c’est honorer.
Honorer les vies, les destins, les gestes, les choix — même ceux que nous ne comprenons pas.
Chercher à comprendre : ce serait déjà juger.
Reconnaître la souffrance sans vouloir la corriger, écouter sans condamner, offrir un espace pour que la mémoire se dépose et s’apaise.
Cette attitude d’inclination, présente dans de nombreuses traditions, ne cherche ni à effacer ni à excuser.
Elle consiste à dire intérieurement :
“Je te vois. Ce que tu as porté, je n’ai pas à le réparer. Je t’honore, et je te rends à la paix.”
En psychogénéalogie, Anne Ancelin Schützenberger parle de “mise en lumière sans appropriation” : il ne s’agit pas de “pardonner à nos ancêtres”, mais de reconnaître leur histoire pour qu’elle cesse d’agir à travers nous.
En constellations familiales, Bert Hellinger, l’inventeur des constellations familiales et systémiques, rappelait que le pardon est souvent un “geste de pouvoir” s’il vient du descendant.
Il privilégiait, comme un chemin de justesse, l’inclination :
“Je te vois. Ce que tu as vécu est à toi. Je l’honore, et je le laisse à sa juste place.”
Et en thérapie du trauma collectif, Anngwyn St. Just évoque le témoignage pacifié : une reconnaissance sans identification, où la mémoire se relie à un champ plus vaste de conscience.
Toutes ces approches convergent : il ne s’agit pas de réparer, mais de laisser respirer ce qui fut.
En honorant sans s’approprier, nous cessons d’alimenter la répétition.
Nous intégrons nos morts, leurs actes et leur passé comme une part vivante de notre propre histoire — non plus dans la rage, la rancune ou l’aveuglement qui furent les leurs, mais comme une ressource au service de l’amour et de la paix.
Dans ce mouvement silencieux, le passé se dépose à sa juste place, et la Vie, apaisée, peut enfin circuler à nouveau.
6. Restaurer la continuité du souffle
Le monde moderne a séparé les morts des vivants, comme s’ils appartenaient à deux réalités étanches.
Pourtant, dans la plupart des traditions, les morts demeurent partie prenante du grand courant de la Vie.
Ce que nous appelons “le deuil” n’est pas une coupure, mais une transformation du lien.
Apaiser les morts, c’est reconnaître qu’ils continuent de respirer à travers nous.
C’est leur redonner place, sens et silence.
Lorsque cette continuité est restaurée, la Vie retrouve sa respiration complète : le visible et l’invisible cessent d’être en guerre.
Dans cette perspective, le travail de mémoire n’est pas commémoration : il est respiration du monde.
Chaque prière, chaque geste de gratitude, chaque parole consciente contribue à rétablir le souffle interrompu.
7. Conclusion – Pacifier le champ collectif
Le monde actuel n’a pas seulement besoin de technologies nouvelles, mais d’une conscience plus vaste.
Les grandes crises de notre époque – climatiques, politiques, spirituelles – sont aussi des crises de mémoire.
Elles nous rappellent que rien ne disparaît tant que cela n’a pas été reconnu.
Apaiser les morts, c’est offrir au monde vivant un peu de paix.
C’est transformer la mémoire de la souffrance en champ de conscience.
C’est permettre à la Vie, d’une rive à l’autre, de circuler librement.
En cette fête de la Toussaint et à la veille de la Fête des morts : ces considérations pourraient servir de terreau à des gestes plus profonds, plus conscients, plus aimant envers nos ancêtres dont les mémoires sont plus vivantes que jamais.
Références citées
Nicolas Abraham & Maria Torok, L’écorce et le noyau, Flammarion, 1987.
Paul Ricoeur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000.
Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, Gallimard, 1972 (éd. orig. 1951).
Françoise Sironi, Bourreaux et victimes, Odile Jacob, 1999.
Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory, Columbia University Press, 2012.
Bert Hellinger, Ordres de l’amour, Les Éditions du Souffle d’Or, 1998.
Anne Ancelin Schützenberger, Aïe, mes aïeux !, Desclée de Brouwer, 1993.
Anngwyn St. Just, Trauma : Time, Space and Fractals, 2010.
Auteur : Axel Trinh Cong [Facebook - Google]
🪶 Texte 100% personnel sur base de mon expérience concrète (et non pas livresque ou théorique) sous forme de témoignage (je ne cherche à convaincre personne).
Ne prenez personne au mot et veillez à exercer votre discernement.
Sentez comment mon texte, ma proposition résonne en vous.
Accueillez ce qui vous parle et laissez le reste là.
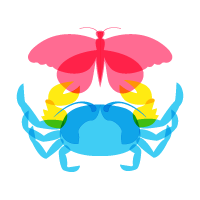

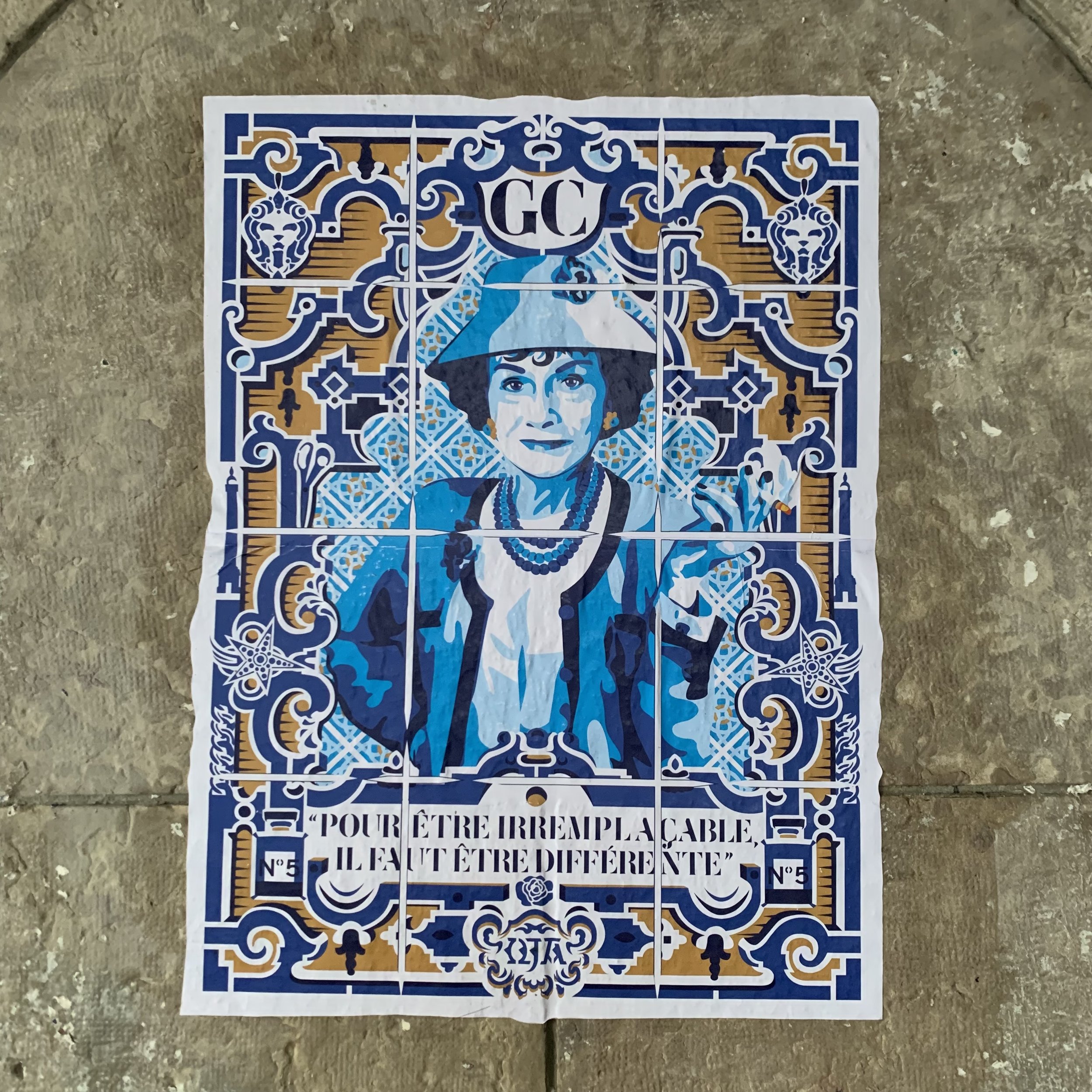








Et si nos blessures collectives n’étaient que la voix des morts qui n’ont pas encore trouvé la paix ?
Apaiser les défunts, c’est restaurer la circulation du souffle entre les rives et redonner au monde vivant la possibilité de respirer pleinement. Témoignage d’un médium thérapeute en constellations familiales (certifié COFASY - 2016).